| | | Édition du mercredi 29 mars 2023 | | | | Parents, enfants, liens familiaux, questions et solutions : chaque mercredi, retrouvez nos articles et conseils autour de la parentalité. |  | Par Clara Georges
Journaliste au Monde | | | Le jour où je suis devenue une vieille schnock | | Ce week-end, lassée d’être coincée dans une alternative unique quant à notre bande-son familiale (Les parents : « On écoute Orelsan ? » /Les enfants : « Non, Envole-moi ! »), j’ai mis un vieil album de Blur. Modern Life Is Rubbish, 1993, un chef-d’œuvre. A ce stade, il peut être utile de vous faire savoir que mon objectivité est compromise, étant donné que j’ai nourri une passion durable pour le groupe de britpop mené par Damon Albarn, au point d’en faire le sujet de mon mémoire de maîtrise, il y a bien longtemps. Mais that’s not the point, comme dirait Damon. Tandis que je fredonnais avec un bonheur infini le refrain de For Tomorrow, j’ai repensé à mes 16 ans. Et là, j’ai vraiment eu une pensée de vieille schnock : je me suis dit que c’était mieux avant. J’ai soudain eu la conviction que mon adolescence était plus légère que celle des jeunes gens que je vois autour de moi. J’ai eu peur que mes enfants, encore petits (8, 5 et 3 ans), ne connaissent jamais cette sensation d’être plus grands que le monde, ces rêves de conquête. Bien sûr, je ne suis pas complètement aveuglée par la nostalgie : rien n’était simple à 16 ans, j’étais mal dans ma peau et torturée et, par ailleurs, j’étais suffisamment privilégiée pour ne pas être lestée d’inquiétudes matérielles. Mais voilà, par-delà les circonstances individuelles, j’ai eu l’impression que quelque chose avait changé. La joie légère et mélancolique de cet album, la badinerie de ces musiciens qui avaient entrepris de raconter une Angleterre éternelle, comme si rien d’autre sur terre n’avait d’importance, tout cela m’a semblé appartenir à un monde dont nous aurions définitivement verrouillé la porte. Un monde d’avant le Brexit, le Covid-19, la menace climatique, la guerre en Ukraine, la crise politique permanente. Un monde où je pouvais être adolescente et ne penser qu’à moi, à mon nombril, mon arcade percée et au prochain concert de Blur – et parfois, manifester contre Jean-Marie Le Pen avec la certitude que la jeunesse triompherait. Dans un article que ma collègue Célia Laborie a consacré à ce que nous avons surnommé « la crise de la vingtaine », la philosophe Claire Marin disait : « Il est devenu plus difficile de trouver sa place, parce qu’on ne peut plus être dans une logique purement égoïste, comme dans ma génération, où chacun se souciait de sa propre carrière, de ses propres choix. Aujourd’hui, certaines préoccupations, notamment écologiques, ne peuvent être abordées que de manière collective. » Cette phrase a la rare qualité de porter à la fois l’espoir (la renaissance d’une pensée collective) et le désespoir (l’impossibilité de faire autrement), me suis-je dit, tandis que dans le salon résonnaient les accords enjoués de Sunday Sunday. J’ai alors fait part à mon compagnon de cette rumination nostalgique. Lui qui est un pôle d’optimisme dans notre couple (il n’a guère le choix, simple question d’équilibre des humeurs) m’a dit que j’idéalisais. En 1993, nous grandissions avec le sida, la chute du Mur, l’angoisse nucléaire, la récession et le chômage de masse, m’a-t-il rappelé. C’est vrai. Alors, en indécrottable pessimiste, je me suis dit que ce qui m’inquiétait ce n’était peut-être pas le présent dans lequel nos ados grandiraient, mais leur horizon. A mon époque, on pouvait encore dire no future sans craindre que cette provoc’ne devienne une réalité physique et thermique. Les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas ce luxe. Si je veux confirmer mes inquiétudes sur le sort de nos enfants, je n’ai qu’à ouvrir un journal : un jeune adulte sur cinq, parmi les 18-24 ans, souffre de troubles dépressifs ; à la Maison de Solenn, structure parisienne de pédopsychiatrie, les consultations ont augmenté de 30 % depuis le début de la pandémie de Covid ; la consommation de psychotropes chez les 6-17 ans explose en France. Mais gare ! Cela ne veut pas dire que j’ai raison. On sait bien que les données de ce genre sont de la pâte à modeler, interprétables à merci, surtout à une époque d’opinions comme la nôtre. Nous retenons des informations susceptibles de nous conforter dans nos convictions. C’est ce qu’on appelle un biais de confirmation, l’un des biais cognitifs dont nous faisons preuve quotidiennement (ça ne vous dit rien ? ouvrez Twitter). Et en voici un autre, de biais cognitif : moi, j’ai 41 ans, je sais comment c’était de grandir dans les années 1990. Mes enfants n’en ont aucune idée, puisqu’ils grandissent ici et maintenant. Leur horizon, ils ne le comparent pas au mien. Ils le regardent bien en face. Et quand je leur parle du bon vieux temps, ils me font bien comprendre que je suis une schnock préhistorique. Ce week-end, j’ai justement lu à ce propos l’opinion de David French, un chroniqueur du New York Times. Il émet (en anglais) l’hypothèse que si les enfants et adolescents sont stressés, c’est parce que leurs parents le sont. Sa théorie, c’est que c’est nous qui avons du mal à supporter l’époque, et qu’en cherchant à en protéger nos enfants, nous faisons rejaillir sur eux notre anxiété. Modern life is rubbish ? C’est nous qui le disons. A la fin de l’album, ma fille cadette a déclaré, d’un ton exaspéré : « Bon, maintenant on met la chanson d’Orelsan ! » Laquelle ? « Ben, “les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes” ! » Ecrivez-moi vos questions, vos réflexions sur parents@lemonde.fr. Je réponds toujours. A la semaine prochaine les schnocks ! | |
| BLOC-NOTES |
Trois voyages, immobiles ou non, que j’ai faits cette semaine : 1. J’ai lu Après Céleste, de la romancière canadienne Maude Nepveu-Villeneuve (Le Bruit du monde, 160 pages, 18 euros). La rencontre d’une jeune femme qui a dû subir une interruption médicale de grossesse, d’une vieille dame qui regarde Maigret, et d’une petite fille qui a perdu sa mère, dans un village du Québec. Au-delà de la beauté étrange de cette langue qui est autre et la nôtre en même temps se dégage de cet ouvrage une quiétude poétique. 2. J’ai regardé Anatomie d’un divorce (Disney+), une minisérie avec Jesse Eisenberg et Claire Danes adapté du roman de Taffy Brodesser-Akner, Fleishman Is In Trouble (2019). Parce qu’on ne peut pas tous vivre à New York, ce bijou d’humour et d’intelligence nous offre the next best thing : des New-Yorkais, et surtout un, ce génial Fleishman en plein divorce et tourment existentiel, avec ses préados et son ex volatilisée. 3. J’ai visité le Doagh Famine Village, sur la côte nord de l’Irlande… où l’on apprend beaucoup sur la famine qui a décimé le pays de 1845 à 1852. Quelques informations folkloriques dispensées nous laissent dubitatifs, comme le fait qu’avant 1845 chaque Irlandais mangeait en moyenne 5,8 kilos de patates par jour. | |
| ET CHEZ VOUS ? « Je me sens plus à l’aise aujourd’hui dans mon rôle de mère que quand ma fille était petite » | | Cécile Abdous, 45 ans, Lyon, mère de deux enfants de 15 et 19 ans : « Mon aînée est partie à 18 ans du foyer pour faire une classe préparatoire. J’avoue avoir été un peu assommée sur le coup, car la décision s’est prise en une semaine. Mais rapidement, notre relation s’est reconstruite et, aujourd’hui, je dirais que nous sommes plus proches que quand elle vivait chez moi. Nous sommes très complices, on s’écrit ou on s’appelle, elle me parle de ses tracas, on a des grandes discussions philosophiques. Je me sens plus à l’aise aujourd’hui dans mon rôle de mère que quand elle était petite. Je n’ai jamais été douée pour préparer des repas moulinés avec des bons légumes, j’étais toujours inquiète qu’il lui arrive quelque chose et j’étais dépassée par l’entretien de la maison et de la famille. La nouvelle relation avec l’enfant demande d’abandonner tous les fantasmes et les projections qu’on pouvait avoir sur le petit qu’on a élevé. Il faut être tolérant, ne pas prendre ses échecs pour les nôtres et inversement. Quand on parvient à être à la bonne place, on découvre son enfant en tant que personne et là c’est la plus belle expérience de la maternité. Cette relation peut devenir une source de bonheur immense. Elle permet d’envisager la pente descendante de la vie avec sérénité, car en tant que parent chéri on sait qu’on aura une place de chef de famille émérite dans le cœur et dans l’esprit de toute la tribu présente et à venir. » Ecrivez-nous : parents@lemonde.fr | | |
| Et chez vous, comment ça se passe? Racontez-nous vos anecdotes de parents, vos petites victoires et défaites du quotidien. Votre retour sera peut-être publié dans cette newsletter. |
| SILENCE, ON LIT | 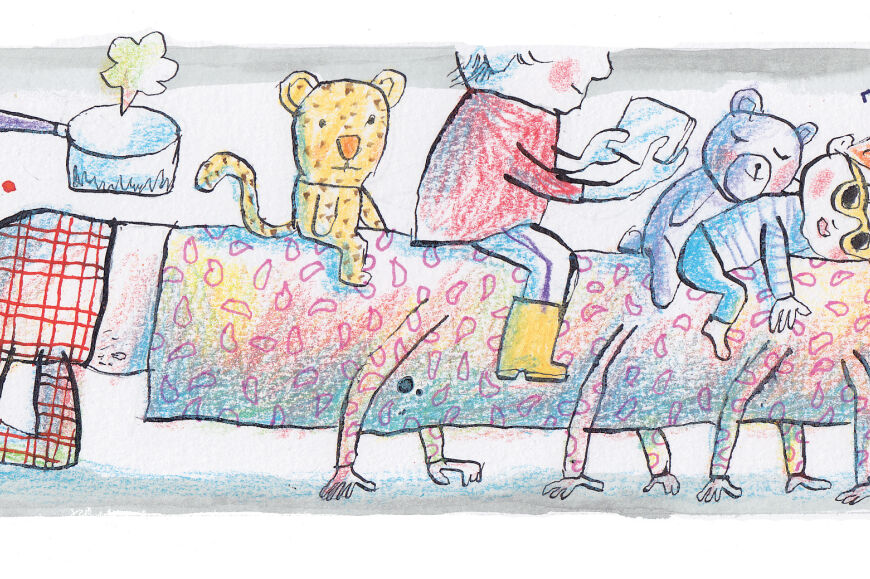 | Philippe de Kemmeter
| | Parentologie : extension du domaine de la peluche Par Nicolas Santolaria  Article réservé aux abonnés Article réservé aux abonnés Chronique|D’objet aidant le bébé à se passer du contact maternel, l’ourson tout doux devient un compagnon rassurant pour les adultes, à l’heure de changements sociétaux radicaux, estime Nicolas Santolaria. | Lire l’article  | Chronique  Comment apprendre à un enfant le respect des autres et le poids des mots ? La psychanalyste Claude Halmos répond Comment apprendre à un enfant le respect des autres et le poids des mots ? La psychanalyste Claude Halmos répond « Le divan du monde ». Dans cette chronique, la psychanalyste s’appuie sur vos témoignages et vos questionnements pour comprendre comment l’état du monde percute nos vies intimes. Claude Halmos Lire l’article  | Tribune  « La proposition de loi sur l’exposition des enfants aux écrans risque de se transformer en “loi de bonne conscience” » « La proposition de loi sur l’exposition des enfants aux écrans risque de se transformer en “loi de bonne conscience” » Les écrans ne doivent pas être considérés uniquement comme des produits potentiellement toxiques, avertit, dans une tribune au « Monde », le psychiatre Serge Tisseron, avant l’examen du texte par le Sénat. Serge Tisseron Lire l’article  | | | | Dans un monde incertain,
soutenez un journalisme fiable |
| AU BONHEUR DES MÔMES  Sélection  Cinq séries pour parents épuisés Cinq séries pour parents épuisés Audrey Fournier Lire l’article  | | |
| Vos retours nous intéressent Partagez votre avis sur cette newsletter avec la rédaction du Monde |
| VIE DE PARENTS | Nicolas Mathieu : « Peu à peu, on sent que la vie commence à faire des cicatrices sur son enfant » « Vie de parents ». Dans cette rubrique, une personnalité évoque les joies et les déboires de son quotidien avec des enfants. L’écrivain de 44 ans s’émerveille des saillies poétiques de son fils de 10 ans, autant qu’il s’agace de parler dans le vide quand il s’adresse à lui. | | Guillemette Faure | |  Article réservé aux abonnés Article réservé aux abonnés |  | | Nicolas Mathieu. ASTRID DI CROLLALANZA | | L’écrivain Nicolas Mathieu a un fils, Oscar. Ses lecteurs connaissent son nom parce que c’est à lui qu’il a dédié Leurs enfants après eux (Actes Sud, 2018). Dans la bibliographie de l’auteur de 44 ans, on connaît ce roman, qui lui a valu le Goncourt, ou encore Connemara (Actes Sud, 2022), un peu moins ses livres pour enfants. Ils semblent écrits pour que son fils les trouve dans une vingtaine d’années – ou à l’âge auquel il démarrera une thérapie. C’est par exemple dans Le Secret des parents (Actes Sud, 2021) qu’on apprend que « si les grandes personnes n’abandonnent pas leurs enfants sur la route comme de vulgaires canettes, c’est que des lois très strictes les en empêchent ». Dans ce même livre, on rencontre Kleber, un enfant qui fait un nœud à son mouchoir pour se souvenir, une fois adulte, qu’il a été enfant (spoiler : si seulement il ne l’avait pas fait dans un mouchoir en papier…). Dans La Grande Ecole (Actes Sud, 2020), Nicolas Mathieu écrit à un enfant dans cet interstice entre la fin de l’été et la rentrée de CP : « Tu as été un peu partout comme font les enfants des parents qui ne s’aiment plus. Deux mois passés et c’est un monde qui est englouti. Je suis le greffier de ce temps révolu. » Et dans le plus récent, Papa (Actes Sud, 2022) : « C’est mal fichu. Il faudrait qu’on reste quelque part, pour toujours, toi un petit garçon, et moi quelqu’un de pas si vieux. » En attendant, Oscar a 10 ans. Il n’est déjà plus un si petit garçon. | Lire la suite  | | |  | | |